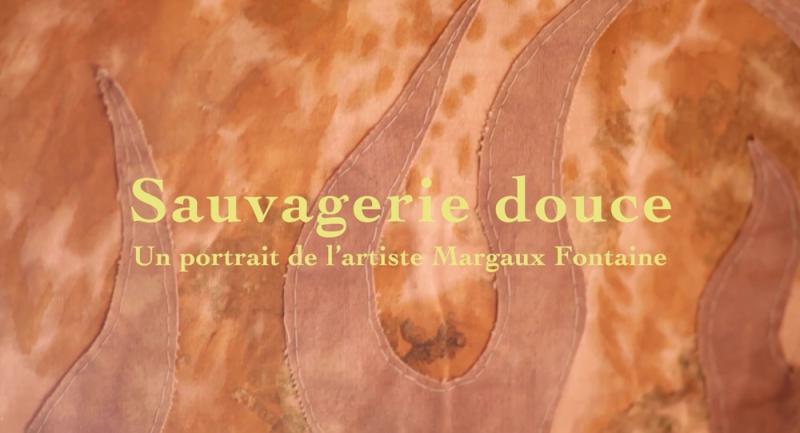Le Parlement des terrestres.
Laurent Puech

Flux énergétique -
La forêt temple, sacrée -
Coeur de nos solstices,
2022, soupe de clous, tataki zomé, teintures végétales, fils à broder, cordes, draps anciens, dimensions variables, vue de l’exposition Mezzanine Sud - Prix des Amis des Abattoirs, Les Abattoirs, Musée - Frac Occitanie Toulouse, 2023, photo Damien Aspe
Depuis plus d’un siècle, le mouvement féministe a modelé d’autres contours à une réalité objective que le point de vue masculin avait fait sienne. Les re-définitions, sous cet angle, pensent une nouvelle compréhension du monde. Le féminisme a transformé en profondeur la société, le droit, la loi et les perceptions de genre des démocraties, ébranlant ces dispositions patriarcales à partir desquelles tout, jusqu’ici, s’ordonnait. De Grande-Bretagne, de France et des Etats Unis d’Amérique des voix d’intellectuelles, de Simone de Beauvoir à Judith Butler, de Virginie Despentes à Donna Haraway, ont théorisé cette vague de fond dont une partie majoritaire du monde, pourtant, ne reconnaît pas l’avancée qu’elle représente pour l’ensemble de l’humanité. Avec plus de difficultés qu’ailleurs, le monde de l’art a dû s’adapter et reconnaître aux artistes femmes une place égale à celle des artistes hommes, une évolution compliquée par le poids d’une tradition qui a occultée pendant des millénaires les voix différentes de la diversité, des femmes et des civilisations extra européennes. Les exemples sont nombreux, et effrayants, de la censure sexiste produite du centre même de l’appareil de création artistique de 1750 à 1950 entre les artistes académiques ou novateurs, les journalistes, les critiques, les marchands et les collectionneurs qui s’entendaient entre eux pour interdire tout autre pilotage. Pourtant que n’a-t-on parlé de « liberté d’expression » à partir de 1900 !
Née en 1989, Margaux Fontaine s’inscrit dans ce mouvement aujourd’hui
victorieux sur l’ordre ancien. Sa génération, qui se situe « par-delà le féminisme » y ajoute une dimension écologique de sorte que les deux revendications politiques touchant à l’universalité de la condition humaine s’y expriment conjointement. Cette plasticienne se place également dans l’expression de l’écosexualité comme en témoigne une œuvre monumentale dans laquelle est réuni sous un chapiteau un cycle iconographique de grandes toiles consacrées à la tente rouge, ce lieu interdit aux hommes où les femmes échangent secrets et rites ancestraux liés à la fécondité à travers des chronologies historiques aussi diverses que les civilisations qui les ont répandues, même à la marge mais jusqu’à elle. La picturalité dans laquelle s’inscrit la démarche de Margaux Fontaine rend plus sensible, quoique moins directe, cette dimension écosexuelle revendiquée chez l’artiste chinois Zheng Bo, né en 1974, photographe et vidéaste qui aborde la pluralité des sexualités notamment par un cérémonial du désir et de la soumission à travers une danse sacrale masculine d’union charnelle à la terre, aux mousses et aux arbres d‘une forêt nordique.

Margaux Fontaine,
Lavande d’été
oiseau de feu solitaire -
La main d’une soeur,
2020, soupe de clous, tataki zomé, fils à broder, ruban, toile, 170 x 170 cm
Les autres œuvres, rassemblées dans l’exposition présentée au château d’Assas par cette artiste, se nourrissent des théories de l’écoféminisme sans négliger la part personnelle, le récit intime d’une jeune femme concernée par l’état du monde qui voudrait concilier les possibilités de transformation des sociétés humaines avec l’émancipation personnelle et une libre expression partagée et diffusée, prenant part au processus salutaire de transformation
de la société pour sauver la terre du désastre qui la menace. Si Margaux Fontaine reste sur une thématique politique, un certain scientisme l’entraîne à pousser les frontières entre humain et végétal, imaginant une nouvelle ère inclusive, accueillant toutes les formes du vivant dans une sorte de parlement universel comme la biologiste féministe déjà citée Donna Haraway le développe dans ses ouvrages. En 1985, dans son Manifeste cyborg, elle professait un rejet de la nature en tant qu’instance de légitimation des mécanismes de hiérarchisation, de domination, de silence, d’oubli. Aussi peut-on dire de cette vision audacieuse qu’elle ne s’apparente en rien au rousseauisme.
Margaux Fontaine puise dans le répertoire conceptuel textile à l’exemple d’Eva Hesse (1936-1970) ou dans celui du de la superposition d’images et de supports d’expression de Joan Jonas, née en 1936. Mais elle s’inscrit davantage dans la suite représentative et presque « naturaliste » de Kiki Smith, née en 1954. Une artiste qui a ouvert la voie aux thématiques de l’écosexualité féministe jusque dans ses dimensions érotiques et mystiques, poussant plus avant les propositions magiques restées confidentielles de la britannique Eleonora Carrington (1917-2011) ou de l’argentine Leonor Fini (1907-1996) à l’époque, déjà ancienne pour nous, du post surréalisme. Comme chez ses illustres aînées avec les références de leur époque, les éléments issus de la culture populaire, des dessins animés et de la bande dessinée sont insérés par Margaux Fontaine à des symboles ésotériques dans une auto narration sans cesse réécrite et dont les motifs entremêlés n’abandonnent jamais la figuration.

Flux énergétique -
La forêt temple, sacrée -
Coeur de nos solstices,
2022, soupe de clous, tataki zomé, teintures végétales, fils à broder, cordes, draps anciens, dimensions variables, détail, photo Damien Aspe
En imprimant des iris, des mauves, des cosmos et des mauvaises herbes
comme le trèfle ou le plantain sur l’hétérogénéité de supports souvent poudrés d’indigo, de garance, de bruyère ou de chêne, convoquant les senteurs distillées des « simples », des papillons et de la cire de colza dans un cercle chamanique, teignant des draps avec des pigments naturels pour y tracer les lignes et les signes hermétiques de notre survie, elle communie avec ses semblables : femmes de l’autre monde, femmes d’un nouveau continent, femmes en révolte contre le naufrage et l’effondrement de l’écosystème. L’artiste sauve le vivant par des broderies obstinées dans une liturgie qui traverse les époques et les civilisations, riche d’expériences non scientifiques, irrationnelles, anarchistes sans catéchisme idéologique et festives. Pourrait-on dire qu’elle ajoute à la série des sorcières modernes analysées par Mona Chollet dans son livre1
, la figure de la femme artiste ?
Riche de l’écoute du monde, de celle de sa mémoire familiale créole et
d’autres mémoires électives d’ami(e)s ou de proches, Margaux Fontaine trouve dans la nature cévenole beaucoup d’éléments en vrai de sa recherche intellectuelle et pratique. Ce paysage végétal luxuriant lui permet de faire part du point de vue du vivant. Immersif et profus, son petit bois de châtaigniers, de chênes et de merisiers offre un lieu privilégié de collecte, d’observation et d’échange avec ceux qui connaissent le même éblouissement.