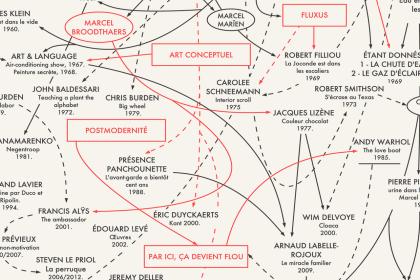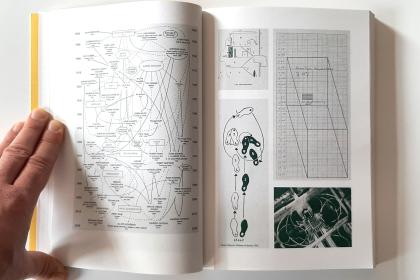Entretien
Bertrand Riou
Bertrand Riou : pourrais-tu revenir pour nous sur ton parcours d’artiste, de l’École Nationale Supérieure d’Arts de Cergy jusqu’à ton implantation ici à Nîmes ?
Steven Le Priol : après avoir quitté l’École de Lorient où j’avais commencé mes études, j’ai rejoint l’École de Cergy dont la pédagogie expérimentale (avant de devenir le modèle des écoles d’art en France) et les professeurs qui y enseignaient me séduisaient. L’École de Cergy était encore une aventure et j’y ai rencontré la plupart de ceux qui allaient devenir les acolytes de mes premières années en tant qu’artiste. J’ai commencé à exposer en France et à l’étranger, faire des résidences, puis en 2008 j’ai intégré la galerie Bendana-Pinel qui me représente encore aujourd’hui. Je suis arrivé à Nîmes en 2013. Je connaissais un peu la région, entre autres pour avoir exposé au CRAC Occitanie et avoir été en résidence à la Villa Saint-Claire à Sète. J’ai rencontré Audrey Martin avec qui je travaillais à l’École Supérieure des Beaux-Arts de Nîmes et c’est elle qui m’a invité à rejoindre le projet de Pamela Artis-Run Space où j’ai rencontré des artistes qui partageaient les mêmes constats sur la situation des artistes à Nîmes, et le même désir de les dépasser.
B.R : comme énoncé dans le texte de Maya Trufaut, ta pratique est teintée « d’un double fictif du réel ». Peux-tu nous en dire plus ?
S.L.P : j’aime employer la formule de « miroir déformant » dans le sens où ce qui va m’intéresser ce n’est pas la fiction pure, mais son rapport à des réalités politiques, sociales ou historiques variées. Même un genre aussi apparemment détaché du réel que la science-fiction, par exemple, tisse à travers son approche prospective un lien avec le réel expérimenté aujourd’hui. Cette question de la perception du réel, de la multitude des expériences vécues multiplie les paradigmes et partage le monde. C’est pour moi une manière de substituer une question ontologique classique « Pourquoi y-a-t-il quelque chose plutôt que rien ? » par une autre qui serait « Pourquoi y-a-t- il cela plutôt que tout le reste ? ». Si mon travail cherche à tromper le spectateur, c’est dans une forme de pacte de croyance entre lui et moi, qui ne fonctionne que s’il est consentant. Quand je parle de double fictif du réel, c’est sous la forme du « revenant », c’est-à-dire le retour du même mais différent, à la fois étranger et familier.
B.R : lors de nos échanges tu m’as raconté pourquoi tu as souhaité garder - avec l’accord des artistes Mazaccio & Drowilal - les peintures murales de leur exposition qui t’a précédée… Je trouve que cette idée est profondément intéressante pour définir un pan de ta pratique. Merci de revenir sur ce sujet pour nos visiteur·ses.
S.L.P : je crois qu’il en va des lieux comme des images. J’aurais pu classiquement demander une remise en état du lieu dans un état neutre, repartir d’une feuille blanche. Je ne crois pas aux choses dans un état de pureté originelle et au contraire ce qui m’intéresse profondément c’est de considérer que toute oeuvre est au fond hantée par tout ce qui la précède. C’est particulièrement vrai dans le cas des documents que je collecte et qui nourrissent une grande partie de mon travail. Souvent les quartiers « sensibles » comme Pissevin sont privés d’Histoire et piégés dans l’actualité du fait-divers. Garder les traces de la précédente exposition avait aussi du sens dans ce contexte, où les politiques de rénovation consistent souvent à simplement effacer ces traces.
B.R : et j’en profite, le titre de l’exposition, qui retrace d’ailleurs presque deux décennies de travail, est un néologisme intrigant. Quelle est sa signification ? Et pourquoi « II » ?
S.L.P : ce néologisme en question, je l’emprunte au laïus philosophique de Jacques Derrida (l’idée qu’une trace visible ou invisible du passé hante le présent). Il tombait à point nommé, puisqu’il suffisait de déplacer le H pour obtenir une homonymie avec le terme anthologie qui vise la présentation exhaustive de l’oeuvre d’un artiste. Le II (en chiffres romains) est là parce qu’il y a eu un premier opus de cette exposition à Pamela qui l’a immédiatement précédée. Je tenais à cette écriture en chiffres romains parce qu’elle était traditionnellement utilisée sur les affiches des films d’horreurs des années 80, mais ce n’est pas que pour des raisons de nostalgie ou de clin d’oeil. Le second épisode de la série Halloween (donc Halloween II) a une particularité remarquable, il démarre exactement au moment où le premier épisode s’arrête, bien qu’il soit sorti au cinéma trois ans plus tard. L’acteur qui joue Michael Myers (le tueur) a changé entre les deux films, mais c’est imperceptible pour le spectateur, encore une fois c’est le retour du même mais différent (d’ailleurs j’ai fait une peinture d’un « mauvais » masque de Michael Myers dans ma série sur les répliques). Pour la suite et dans une certaine logique la restitution de ma résidence au Carré d’Art s’intitulera Hantologie III, inscrivant ainsi les trois évènements dans un corpus commun.
B.R : excellente continuité en effet. Ton univers me fait penser de façon positive à un copycat, dans tous les sens du terme, mais surtout celui qui est fasciné par le modus operandi des serial killers. Je t’avoue que moi aussi je suis passionné par ce sujet. Doit-on s’en inquiéter ou au contraire se plonger plus encore dans cette fascination ?
S.L.P : pour reprendre le registre que tu cites, mes expositions fonctionnent d’une certaine manière comme des escape games où les clés d’une œuvre sont souvent à trouver dans une autre. Pour ce qui est du modus operandi dont tu parles, elle rejoint la question des processus qui est centrale dans l’art contemporain. En paraphrasant le titre d’un projet artistique célèbre, j’aime dire que : Les processus appartiennent à tout le monde (c’est ce que n’a cessé de
démontrer une artiste comme Elaine Sturtevant). La question du copycat que tu soulèves en soulève une autre, celle de l’auteur. Je ne sais si c’est à ça que tu penses mais ta question me mène à penser au travail de Stéphane Étienne, cet artiste de fiction dont je produis le travail depuis quelques années. Parce que ce qui m’a amené à ça c’est justement cette question du processus. Stéphane Étienne est un artiste qui m’a été inspiré par les personnages de Bouvard et Pécuchet du roman de Flaubert (qui eux-mêmes sont inspirés de Homais, le pharmacien de Madame Bovary, dont Flaubert avait pensé qu’il pourrait comprendre à un moment du récit qu’il est justement un personnage de roman, anticipant ce rapport flou entre réel et fiction dont on parlait). Bouvard et Pécuchet n’ont qu’un savoir livresque, ce qui leur permet uniquement d’aller d’un échec à un autre. Ils n’ont que des processus qu’ils tentent de reproduire en vain. Inventer des processus que je produis en étant caché derrière la figure d’un artiste fictif, c’est une manière de jouer avec ironie sur cette question et de poser un regard critique sur les habitudes post-conceptuelles de l’art dominant dans les institutions et les écoles d’art.
B.R : l’enchainement des deux expositions au CACN est synchrone car vous parlez de sosies, d’appropriation, de « reproductions de reproductions ». Ton intérêt pour la citation pourtant - dont le XXIè siècle est le parangon - va a contrario avec tes tentatives de contrôler ton image dans tes oeuvres plus autobiographiques. Il y a-t-il un lien entre tout cela ? D’après le texte de Maya Trufaut et bien non, il faut renoncer à rationaliser, se bercer dans ton imaginaire… suivre le lapin blanc ?
S.L.P : on peut mais en se souvenant que c’est toujours le réel qui gagne à la fin, parce que plus que de contrôler mon image il s’agit certainement de la laisser filer. Sur le site internet d’une institution publique importante on m’a attribué une œuvre qui n’est pas de moi. J’aurais pu depuis le temps demander une correction mais je ne le fais pas parce que cette situation m’amuse au fond. On est parfois à la limite du quiproquo de comédie (un collectionneur a contacté mon galeriste pour acheter cette pièce, que j’ai prétendu avoir déjà vendue, tandis que la vraie pièce a bien été vendue par son véritable auteur à un Frac). Il m’arrive régulièrement que dans des articles ou des biographies mon nom, ma date ou mon lieu de naissance soient modifiés. J’aime vivre avec ce double et je l’entretiens parfois. Je pense à cette situation où on finit par correspondre de moins en moins à son image publique, comme dans cette anecdote selon laquelle Charlie Chaplin serait arrivé un jour troisième à un concours de sosies de Charlot.
B.R : je pense à une de tes dernières peintures, celle d’Arnold Schwarzenegger (à retrouver à la galerie Bendana-Pinel, Paris), et ton concept autour du naturisme - culturisme / nature - culture. Quelles sont les références dont tu t’empares ici ?
S.L.P : Naturisme et Culturisme a été une notion centrale de mon travail dans la période où je me suis un peu écarté du métier d’artiste. C’est devenu un thème de recherche que j’ai commencé à explorer et dont je partageais les résultats sur un site internet dédié. En fait l’idée était de partir des notions de Nature et Culture (qui sont souvent utilisées comme introductions à la pratique philosophique) pour y ajouter des suffixes en « isme » qui évoquaient des disciplines issues du territoire du développement personnel et de ses recettes toutes faites. En 2016, c’est devenu le titre d’une exposition où j’exposais une partie de mes résultats. J’y explorais à travers les pièces exposées des pratiques diverses autour du rituel (comme les rêves lucides, le bizutage étudiant, le yoga des mains et la langue des signes des gangs…) et je commençais à explorer plus loin ces questions d’hantise et de réminiscences. De la même manière que Karl Marx le formulait dans le manifeste du parti communiste en disant « Un spectre hante l’Europe, le spectre du communisme », je mettais en avant qu’un spectre hante la culture contemporaine, le spectre de l’occultisme psychanalytique mâtiné de contre-culture ésotérique tordue. Ça a fini d’ailleurs par alimenter toute une série de mes cours théoriques.
B.R : pour conclure cet entretien, que le texte de Maya et l’équipe de médiation complètent, peux-tu nous expliquer le sens de la vidéo The End présentée dans l’exposition au centre d’art ?
S.L.P : j’ai souvent un problème avec la vidéo dans les expositions dont je trouve les dispositifs de monstration habituels parfois mal opérants. On tombe au coin d’une cimaise sur une vidéo qui joue sans qu’on sache où on en est de son déroulement narratif, à quelle distance on se tient de son début ou de sa fin. C’est pour ça que je préfère produire des vidéos en boucle qui annulent ce rapport à la temporalité du récit. The End est l’illustration littérale de ce constat puisqu’il s’agit d’une suite de mentions « the end » issues de différents films montées en boucle. Le premier intérêt pour moi c’est de parler de ces mentions désuètes qui apparaissaient à la fin des films, qui n’existent plus aujourd’hui, mais qui fonctionnaient justement comme des avertissements de la fin de la fiction et du retour au réel. Ensuite, construire une boucle d’annonces de fin qui ne finissent jamais de s’évaporer les unes dans les autres, séduisait mon goût pour les pièges et les faux-semblants.